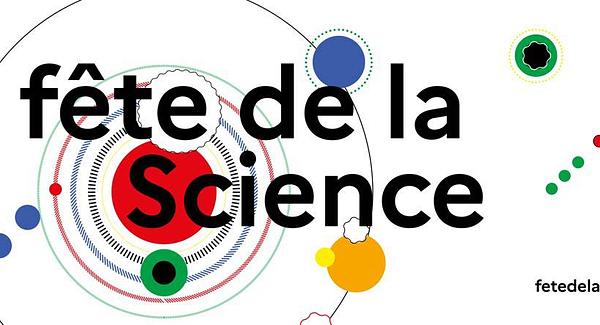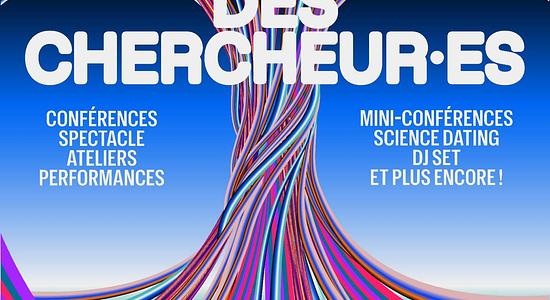De l'hystérie à l'intelligence artificielle, la conscience au cinéma
Emmanuelle ANDRÉ, Professeure de cinéma et d’études visuelles à l’université Paris Cité présentera la manière dont le cinéma invente une image de l’homme qui accompagne et anticipe les découvertes scientifiques, jusqu’aux récents travaux des neurosciences cognitives.
Cette conférence a lieu dans le cadre de la Fête de la science, qui explore cette année le thème des « Intelligence(s) » sous toutes ses formes et dans le cadre du bicentenaire du neurologue Jean-Martin Charcot auquel nous consacrons une partie de l’exposition temporaire « La figure du savant au chercheur d’hier à aujourd’hui ».
La coïncidence entre l’invention du cinéma et l’invention de la psychanalyse a été souvent commentée, les films ayant eux-mêmes relayé la correspondance des motifs qui se développent tout au long des XXeet XXIe siècle. L’hystérie en revanche a très vite disparu des hôpitaux, où elle n’est plus diagnostiquée dès les premières années du XXe siècle. Pourtant, les images de l’hystérie perdurent et, avec elles, une idée de la mise en scène qui met à mal la représentation de l’homme. On étudiera dans cette communication la manière dont le cinéma invente une image de l’homme qui accompagne et anticipe les découvertes scientifiques, jusqu’aux récents travaux des neurosciences cognitives. Une autre manière de poser le problème qui nous intéresse serait de se demander pourquoi, dès 2001, le film de Steven Spielberg, symptomatiquement intitulé AI, débute par une citation explicite du tableau que le peintre Pierre-André Brouillet consacre à la Leçon clinique du Professeur Charcot (1887) ? De la fin du XIXe siècle à la fin du XXe siècle, la « conscience » change de figure et d’allure et, avec elle, la mémoire humaine, dont le cinéma réinvente incessamment les formes.
De 18:30 à 19:30